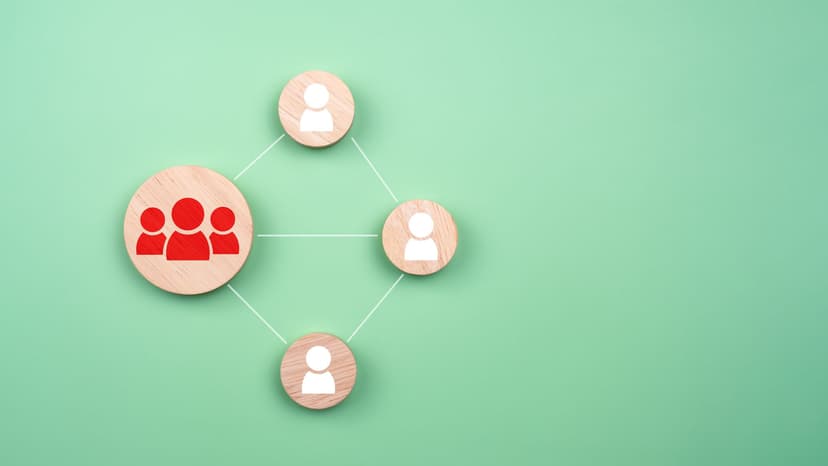Avoir un taux de turnover faible : la fausse bonne nouvelle ?

🔍 Le taux de turnover, quesako ?Il s’agit du roulement des effectifs d’une entreprise. Il comprend à la fois les départs, mais aussi les entrées de personnel.
Le marché du travail post-Covid est largement en faveur des candidats. Alors, les travailleurs se sentent plus libérés (même délivrés) que jamais : les voilà qui n’hésitent plus à enchaîner les relations de courte durée. Dans ce contexte, le taux de turnover explose, atteignant dans certaines boîtes jusqu’à 30 à 40% des effectifs.
Pour les RH, voilà un horrible casse-tête pour que les entrées compensent les sorties, exigeant un effort permanent sur le recrutement. Avoir un taux de turnover trop élevé n’est effectivement pas un bon signal envoyé en termes de marque employeur. “Cela suggère qu’il y a un problème de rétention des compétences, une expérience salarié insatisfaisante, ou des problèmes liés à la qualité du recrutement”, affirme Nicolas Lepercq, Responsable R&D du laboratoire RH d’Ignition program.
Ni trop… ni pas assez
Mais il ne faut pas croire non plus qu’un taux de turnover faible soit une excellente nouvelle pour l’entreprise. “Le sujet du turnover est souvent mal compris. On pense qu’un taux bas est une bonne chose, ou que ce n’est pas alarmant, car les effets vont s’apprécier sur le long terme”, souligne Nicolas Caillet, Consultant senior en Ressources Humaines.
Si au-delà de 15%, on peut considérer que le taux de turnover est élevé (bien qu’il faille contextualiser ce pourcentage avec le marché), il est communément admis qu’un taux de turnover entre 0 et 3% est trop faible. “Chez Ignition, nous considérons même qu’en dessous de 5%, cela peut poser un certain nombre de problèmes”, poursuit Nicolas Lepercq.
Les DRH doivent donc s’inquiéter du taux d’usure de leurs collaborateurs. Bien sûr, ces chiffres sont à mettre en corrélation avec le type de structure : un grand groupe peut avoir un taux de turnover faible parce que les possibilités de mobilité interne sont grandes, et que les entrées et les sorties se font uniquement au sein du corps social déjà en place. À l’inverse, il est normal qu’un salarié de startup ne se projette pas à plus de 2 ou 3 ans dans l’entreprise.
🔍 Avec un taux de turnover de 3%, il faut 30 ans pour renouveler son personnel.
La rédaction vous conseille
Je ne t’aime plus, mon amour
Pour illustrer la problématique, commençons par une petite histoire. Nicolas Lepercq se souvient d’une situation rencontrée lors de l’un de ses précédents jobs en tant que consultant. À l’époque, il accompagne la société qui exploite la Tour Eiffel. Nous sommes à la fin des années 90. Les salariés qui assurent les visites y travaillent depuis plus de 15 ans. Pourtant, au départ, il ne s’agissait que d’un job étudiant. “Ces étudiants ont été rémunérés avec un variable par rapport au nombre de visiteurs passés sur le site. Au final, ils ont pu gagner entre 3 à 4 fois le SMIC pour un job à temps partiel”, raconte notre interlocuteur.
Sur le papier, on se dit que c’est formidable. Sauf que ces salariés sont malheureux comme les pierres. Incapables de quitter leur job, ils savent pertinemment qu’ils ne retrouveront pas le même niveau de rémunération. Sauf que, après des années à arpenter les escaliers de la Tour Eiffel, ils n’ont plus tellement la flamme. Parmi les conséquences directes : des arrêts maladie, des situations de conflits, des conséquences sur l’accueil des visiteurs, un déficit pour l’image de la boîte en externe.
Bref, ils ne s’aiment plus… mais sont incapables de se quitter. Une étude menée par Ignition Program démontre que ce qui s’est passé avec cette bonne vieille Tour Eiffel vaut ailleurs : les salariés ayant un taux d’ancienneté élevé affichent un taux de satisfaction plus faible. Nicolas Lepercq ajoute aussi qu’il n’est pas une caricature que de dire que les fonctionnaires du public sont plus insatisfaits que ceux du privé. Les travaux d’Ignition le prouvent aussi. “Ayant la garantie d’avoir un emploi à vie, les fonctionnaires préfèrent rester en place même si leur job n’est pas ou plus satisfaisant”, explique-t-il.
Il est temps à nouveau
Le problème, c’est que lorsqu'un salarié n’est pas épanoui, il y a moins de chances qu’il soit performant. “Les salariés qui sont en place depuis longtemps jouissent d’un privilège d’ancienneté qui fait qu’on les considère comme plus compétents simplement pour cela, mais ce n’est pas forcément corrélé à la réalité”, souligne Nicolas Caillet.
De plus, même si les collaborateurs laissent penser qu’ils n’aiment pas le changement, ils en ont pourtant besoin : de nouvelles têtes, de nouvelles pratiques… pour briser la routine. Pour Nicolas Lepercq, il est effectivement essentiel d’offrir une respiration en faisant tourner un minimum les effectifs.
Sans compter qu’un turnover trop faible peut engendrer des conséquences au niveau business à plus long terme en raison d’un effet générationnel. Les jeunes peuvent se sentir mal à l’aise de rejoindre une entreprise avec une moyenne d’âge élevée, privant ainsi ces sociétés de la représentation d’une partie des consommateurs.
L’autre effet encore plus inquiétant est le risque d’un défaut de transfert des compétences. Notre expert d’Ignition Program illustre cette problématique avec la vague de recrutements qu’a connu le secteur de la banque au début des années 2000. Le hic, c’est qu’une grande partie du personnel risque de partir en même temps, provoquant un trou dans la raquette et un risque de rupture des compétences en interne. “C’est ce qu’on appelle un trou dans la cohorte générationnelle”, pointe Nicolas Lepercq. Un manque de turnover risque ainsi d’engendrer un défaut de diversité, y compris générationnelle.
Un risque pour les top performers
On n’y pense pas au premier abord, mais un taux de turnover peut poser de vrais soucis pour la rétention des profils les plus prometteurs. “L’entreprise ne peut alors pas leur offrir assez d’opportunités d’évolution car ça ne bouge pas assez en interne. Ceux-ci risquent d’être les premiers à partir alors que ceux ayant une employabilité moins élevée sont plus sujets à rester en poste”, souligne Nicolas Caillet.