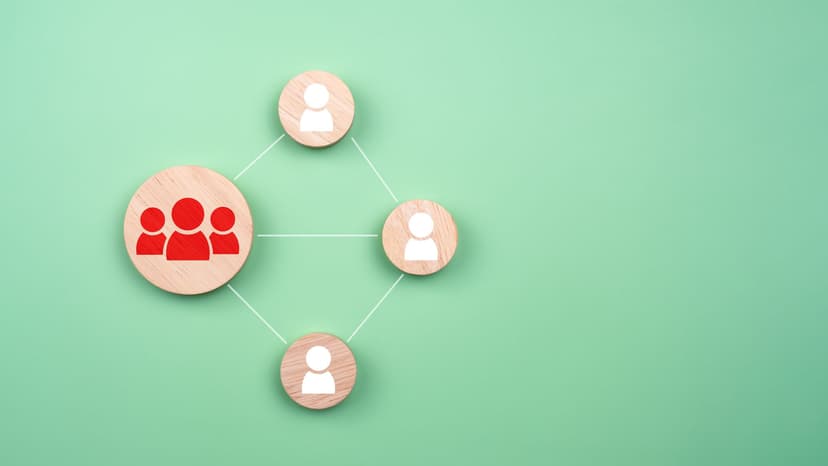Le train est-il devenu une extension du bureau ?
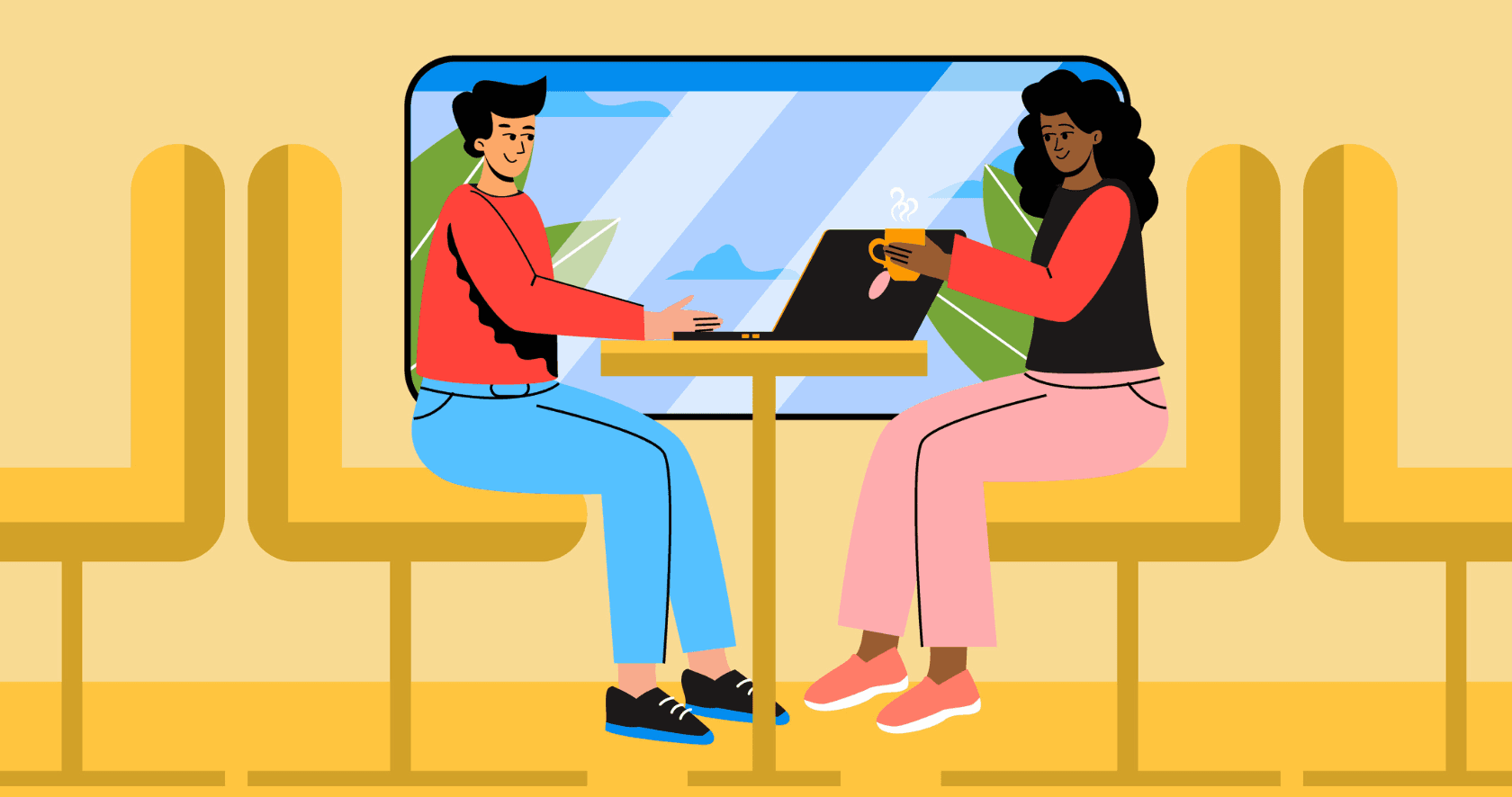
Il y a 5 ans, Nicolas, Directeur de recherche au sein du groupe Kardham, déménageait dans un village non loin de Caen avec sa famille, tout en conservant son job à Paris. Depuis, il continue à se rendre trois fois par semaine sur site. Porte-à-porte, son trajet dure près de 5h, combinant scooter, train et métro. Concrètement, cela signifie un lever sur les coups de 6h, et un retour vers 20h15 à son domicile.
“Au final, j’arrive à la même heure que les autres le matin, vers 9h15, et je rentre paradoxalement plus tôt chez moi que lorsque je vivais dans les Yvelines car j’accepte moins de rendez-vous tardifs”, nous confie-t-il. S’il estime tenir le rythme, il n’empêche qu’il a souvent l’impression d’avoir vécu une première journée avant même d’arriver au bureau.
Un lieu pour socialiser ?
Semaine après semaine, il retrouve les mêmes têtes dans le wagon réservé aux abonnés. “C’est une volonté de la SNCF, cela nous permet de ne pas réserver ce qui enlève une partie du stress. On ne craint pas de louper notre train”. De là à nouer des amitiés avec ces co-voyageurs ? “Au début, je pensais que j’allais discuter avec les autres navetteurs. Mais en réalité, l’ambiance est studieuse”, note-t-il.
Un état de fait confirmé par Camille Rabineau, fondatrice du cabinet Comme on travaille, qui a elle-même mené des études sur le sujet. “En semaine, sur les lignes type Lille-Paris ou encore Paris-Lyon, il est rare que les voyageurs discutent”.
Pour délier les langues, rien de tel que la cohabitation des usages, comme lorsqu’une personne part en vacances et se montre ouverte au dialogue. “Cela nous rappelle que prendre le train chaque jour pour travailler demeure atypique, et que ce moyen de transport est à l'origine avant tout dédié au voyage de loisir”, analyse-t-elle.
Une plage idéale de deep work
Alors qu’il nous berce de son doux murmure, le train représente aussi pour nombre de voyageurs un passeport vers la rêverie. “C’est vrai que lorsque je suis dans le train, je me sens comme dans un cocon”, reprend Nicolas. Lors des froides matinées d’hiver, ses voisins sont d’ailleurs nombreux à terminer leur nuit, flanqués d’un petit plaid sur leurs genoux, tandis que notre interviewé s’endort au son d’un podcast.
Pour autant, point de repos pour les braves. Souvent, les navetteurs se sentent redevables et repoussent les limites pour que leur domiciliation n’entrave pas leur carrière. “Quand je quitte le bureau à 17h30, il est évident que je poursuis ma journée de travail dans le train, souvent en lisant des ouvrages pour nourrir ma réflexion”, raconte notre grand voyageur.
Placé dans un état de flow, préservé de toute distraction cognitive (car on ne peut pas dire que le réseau dépote dans le train), il peut se concentrer sur ses tâches de deep work.
💡 À retenir : dans un open space, les interruptions peuvent représenter jusqu’à 20% du temps de travail perdu chaque jour (INRS). Dans le train, le bruit “blanc” du roulement agit parfois comme un filtre, moins intrusif que les conversations de collègues.
Une expérience à deux vitesses
Si le bureau peut être propice au travail, Camille Rabineau tient cependant à souligner qu’en matière de transport, tous les Français ne roulent pas à la même vitesse. Impossible de comparer le capharnaüm de la ligne TER Nice-Marseille avec la quiétude d’un Paris-Tours.
Dire que le train est une extension du bureau lui semble donc être un retournement de l’histoire. “Il ne faut pas oublier qu’à l’origine, les trajets domicile-travail représentent un vrai risque pour la santé des travailleurs (accidents, fatigue, attaques sexistes…). Sans oublier l’impact de l’intermodalité et tous les aléas qui peuvent survenir et nécessitent une solide organisation familiale”, analyse l’experte.
En effet, le temps moyen domicile-travail en France est de 1h par jour, mais dépasse 1h30 en Île-de-France (Insee, 2021). Le cas de Nicolas (près de 5h) reste exceptionnel, même si les “grands navetteurs” seraient aujourd’hui environ 1,8 million en France (personnes parcourant plus de 2h par jour) (France Stratégie, 2022).
La rédaction vous conseille
Un effort… et un coût
Au final, selon la ligne empruntée, l’expérience est bien différente pour les navetteurs. Il faut aussi avoir conscience du coût de ces trajets quotidiens, pas toujours accessibles à toutes les bourses. Nicolas dépense près de 5 000 euros par an (dont la moitié prise en charge par son employeur). À titre de comparaison, l’abonnement annuel TGV Max ou forfait travail peut coûter entre 250 et 400 euros par mois selon les lignes (SNCF Connect).
De fait, tout le monde n’a pas accès à une ligne TGV et au salon Grand Voyageur. Le train comme “bureau mobile” est donc un privilège de cadres, dans des conditions de confort qui varient du tout au tout.
Une qualité de vie réinventée
Pour Nicolas, point de doute : les 5h de trajet sont clairement compensées par une qualité de vie incomparable avec l’Île-de-France. “Pour moi, l’effort est très relatif. C’est presque comme si j’habitais en lointaine banlieue, avec un transport bien plus confortable”, lance-t-il.
Et si, finalement, ce bureau sur rails n’était qu’un nouveau compromis : accepter des kilomètres avalés chaque semaine pour mieux goûter au calme d’un jardin normand le soir venu ?