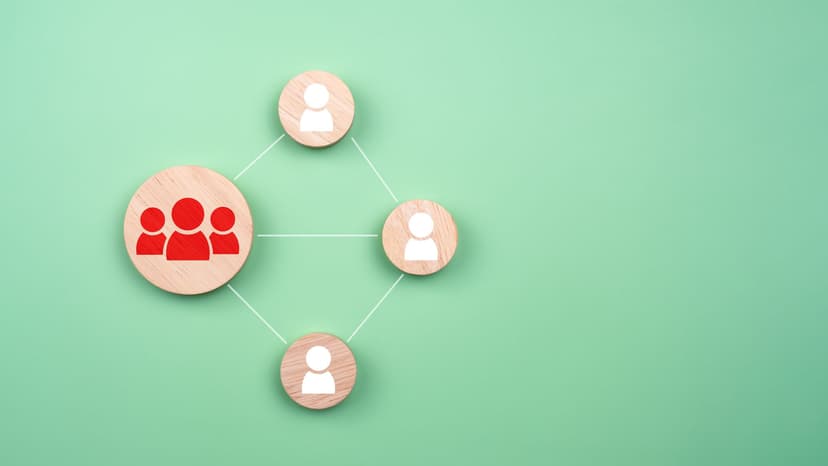Que peut-on exiger légalement et “moralement” d’un collaborateur qui s’en va ?

Qu’il soit voulu ou subi, le départ d’un salarié plonge presque toujours employeur et employé dans un tourbillon d’émotions. Qui plus est quand ces au revoir sont mal préparés : “On parle beaucoup d’onboarding, mais la phase d’offboarding, c’est-à-dire l’accompagnement du départ, est trop souvent négligée alors qu’elle est cruciale”, souligne Charline Keller, cofondatrice de Tie-up.
“Lorsque le départ d’un salarié se passe mal, l’employeur a souvent tendance à se retrancher derrière les aspects légaux, au détriment de la relation humaine”, observe Yann Vaucher, Docteur en Business Administration et directeur de Leonardo3.4.5. Mais outre les dispositions légales, il y a aussi la morale personnelle et l’éthique professionnelle.
Alors, de nombreuses questions se posent sur ce que l’on peut ou non exiger d’un collaborateur sur le départ. Faut-il lui demander de demeurer engagé jusqu’au dernier jour, ou accepter de lâcher du lest ? Quelle est la juste voie du milieu ?
Ce que la loi impose réellement
Sur le plan légal, Arnaud Teissier, avocat associé au sein du Cabinet Capstan, rappelle que “la durée du préavis est généralement définie par la convention collective” et que, sauf faute grave ou lourde, le salarié doit respecter cette période. Cette phase permet une transition nécessaire, un temps de “respiration” entre la rupture du contrat et le départ effectif. Pendant le préavis, le salarié doit continuer à fournir sa force de travail normalement, “avec un engagement loyal et professionnel”.
Toutefois, en cas de démotivation ou de conflits, l’employeur peut dispenser le salarié de ce préavis, ce qui l’oblige à le rémunérer, sauf exception. La loi n’impose pas au salarié d’organiser une passation écrite ou un transfert complet de ses dossiers, même si c’est une bonne pratique très répandue. En revanche, le respect des clauses de confidentialité et de loyauté, qui perdurent après le départ, est un impératif juridique. Par exemple, un salarié ne peut pas débaucher ses anciens collègues chez un concurrent ni divulguer des secrets industriels.
Autre point essentiel, souvent mal compris : la clause de non-concurrence. Arnaud Teissier rappelle qu’elle doit être justifiée, limitée dans le temps et l’espace, et accompagnée d’une contrepartie financière, faute de quoi elle peut être inapplicable. Beaucoup d’employeurs omettent de lever cette clause ou de payer la contrepartie, ce qui peut poser problème.
Enfin, le collaborateur doit restituer tout le matériel de l’entreprise (ordinateur, téléphone, badge, documents internes). Charline Keller souligne que partir avec des documents sensibles peut relever du vol et entraîner des poursuites judiciaires.
Le cadre moral et éthique : un contrat implicite
Si la loi fixe un cadre, le volet moral reste fondamental. Et c’est sans doute ici que le sujet peut devenir explosif. Or, “respecter ses obligations à la fin d’un contrat ne dispense pas de soigner la manière : le départ d’un collaborateur mérite considération et reconnaissance, de part et d’autre”, explique Yann Vaucher. Pour cela, de plus en plus d’entreprises mettent en place des processus d’offboarding, qui définissent à la fois les devoirs contractuels et les bonnes pratiques relationnelles attendues par chaque partie, et jusqu’au dernier jour de travail.
Charline Keller évoque de son côté “un contrat moral“ : on ne peut pas obliger un salarié à recruter ou former son successeur, mais on peut espérer qu’il joue le jeu en aidant à la passation, en documentant ses dossiers et en ne nuisant pas à l’entreprise ou à ses partenaires. “C’est une question de bonne intelligence”, dit-elle. Si le salarié se comporte mal, cela compromet tout l’équilibre.
Marie Liesse Morgaut, Managing Director chez Nexmove, complète ce tableau en rappelant qu’un collaborateur doit pouvoir continuer à être impliqué dans son travail jusqu’au dernier jour. L’entreprise peut attendre de lui “qu’il prépare la personne qui va lui succéder, avec le même niveau d’implication qu’il avait pour exercer ses fonctions”. Cela pose cependant des limites : il est difficile, voire déraisonnable, de demander à ce salarié de s’investir sur de nouveaux projets ou sur des tâches qui ne le concernent pas.
Gare à la placardisation !
Yann Vaucher ajoute que le soin apporté aux relations humaines jusqu’au jour du départ est essentiel. Une politique claire de gestion des départs, qui intègre reconnaissance et respect, permet au contraire de maintenir un climat professionnel serein. De son côté, il évoque la “charte de départ” comme étant une bonne pratique.
Il peut arriver cependant que le collaborateur sur le départ soit mis sur le banc de touche : on lui parle moins, on le considère presque comme absent avant même la fin de son préavis. Pourtant, même si la personne quitte l’entreprise, elle a été investie plusieurs années dans une expérience collective.
“Le phénomène de « placardisation » est vraiment néfaste, car le collaborateur a besoin de reconnaissance jusqu’à la fin des rapports de travail. Quand on met quelqu’un « de côté », cela peut nuire à la qualité des relations dans l’équipe, décrédibiliser le management, et surtout, laisser une mauvaise image de l’entreprise, ce qui est délétère en termes de marque employeur”, constate Yann Vaucher.
La rupture conventionnelle et ses limites
La rupture conventionnelle est souvent perçue comme la solution idéale pour partir à l’amiable, mais elle n’est pas un dû. Charline Keller rappelle que refuser une rupture conventionnelle n’est pas du harcèlement ni un abus de pouvoir de l’employeur. Elle recommande une approche pragmatique : accepter cette rupture si elle correspond à un projet professionnel réel et clair, refuser si elle est utilisée comme moyen de pression.
Arnaud Teissier souligne que la rupture conventionnelle permet au salarié de bénéficier des allocations chômage, ce qui n’est pas le cas en général d’une démission. Toutefois, une rupture conventionnelle n’est pas un droit acquis : elle suppose un consentement des deux parties (le salarié et l’employeur). Elle peut donc engendrer des tensions si elle est mal négociée, et davantage lorsqu’elle est refusée.
L’impact du départ sur la marque employeur et le collectif
L’enjeu dépasse la simple relation individuelle. Charline Keller alerte sur “l’effet hémorragique” dans les petites structures où le départ mal géré d’un collaborateur peut en entraîner d’autres, voire dégrader durablement l’ambiance de travail.
À l’inverse, un départ respecté et accompagné “renforce la marque employeur“ et peut même créer des salariés “boomerangs”, prêts à revenir dans l’entreprise. Yann Vaucher confirme que dans un monde ultra-connecté, avec les réseaux sociaux et les plateformes de notation des employeurs, une bonne gestion du départ d’un collaborateur influence positivement la réputation de l’entreprise.
En somme, le départ d’un collaborateur ne se limite pas à la fin d’un contrat de travail. Il engage une phase délicate où la loi fixe des cadres essentiels, mais où la morale, l’éthique et la relation humaine jouent un rôle primordial. Exiger de son collaborateur qu’il respecte ses obligations légales est une évidence, mais l’exigence morale appelle à un équilibre subtil entre respect, reconnaissance et pragmatisme.
Une gestion soignée des départs contribue non seulement à préserver la sérénité du collectif, mais aussi à valoriser la marque employeur et à garder la porte ouverte à des relations futures, qu’elles soient professionnelles ou humaines.
3 bonnes pratiques à retenir
- Pour l’employeur : instaurer une politique claire d’offboarding avec des chartes, entretiens de départ, accompagnement au changement. Permettre un temps partiel en fin de préavis pour préparer la suite. Ne pas placardiser ni dénigrer le salarié. Valoriser l’expérience passée.
- Pour le salarié : respecter la durée du préavis, continuer à travailler professionnellement, aider à la passation sans obligation formelle, restituer le matériel, respecter la confidentialité et la loyauté.
- Pour les deux parties : privilégier la communication, éviter les ruptures conflictuelles, envisager la rupture conventionnelle quand elle correspond à un projet clair.