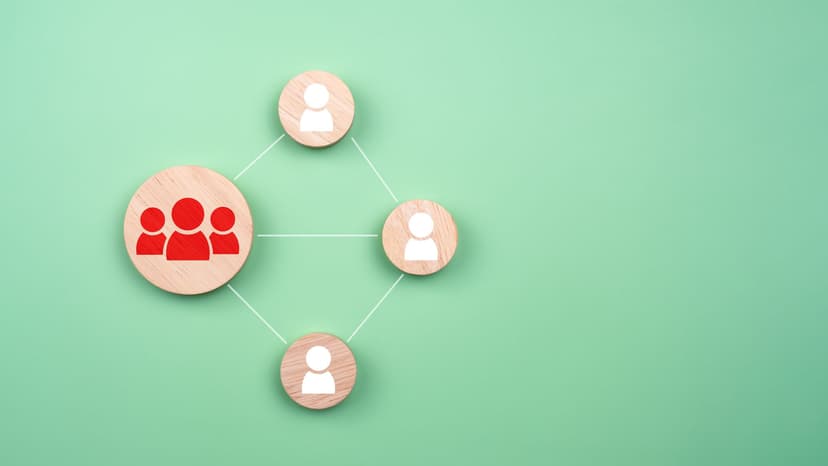Tabou, stigmatisation, galère procédurale : la difficile reconnaissance du handicap invisible au travail

Nicolas, 46 ans, est atteint de schizophrénie. Lena, 25 ans, est épileptique. Fabrice, 56 ans, a un trouble bipolaire. Tiffany, 31 ans, souffre de fibromyalgie et a été diagnostiquée TDAH. Matthieu, 46 ans, a longtemps été malvoyant avant de devenir aveugle.
Leur point commun ? Ils et elles vivent avec un handicap invisible et ont été confronté‧es à la demande de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur‧euse Handicapé‧e), un statut créé pour faciliter la recherche d’emploi des personnes en situation de handicap, et améliorer leur quotidien au travail.
Entre croyances limitantes, discrimination, défaillances procédurales, ils et elles nous partagent leur vision de la RQTH et, pour certain‧es, leur parcours du combattant.
Seul 1/4 des personnes handicapées ont la RQTH
S’intéresser à la RQTH, c’est pénétrer dans un labyrinthe dont on n’est pas sûr‧e de trouver l’issue. En bossant sur ce sujet, les enjeux m’ont paru vertigineux : à chaque fois que je soulevais une pierre, j’en découvrais une autre juste en dessous.
La réalité, c’est que le système des RQTH est comme une fusée dysfonctionnelle à tous les étages : médecins traitants, médecine du travail, MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées), France Travail, entreprises… Tous concernés, tous défaillants.
Aujourd’hui, en France, sur les 12 millions de personnes vivant avec un handicap, seules 3,1 millions bénéficient d’une RQTH (France Travail, 2023). En première ligne, les porteurs‧euses d’un handicap invisible, qui subissent la double peine du handicap : selon une récente étude Opinion Way, près de 60% des salarié·es interrogé·es ayant un handicap invisible n’ont aucune reconnaissance officielle de leur pathologie.
Pourquoi les trois quarts des personnes en situation de handicap ne sont-elles pas reconnues comme travailleurs‧euses handicapé‧es ? Pourquoi sont-elles si peu nombreuses à en faire la demande ? Et pourquoi ces problématiques sont-elles particulièrement prégnantes dans le cas du handicap invisible ?
Déni, illégitimité : des freins subjectifs
“Ça a été difficile à accepter, le fait d'avoir un handicap”
“On se sent réduit, différent. Un jour, on a un statut, on est travailleur, on gagne son argent pour vivre et, du jour au lendemain, on doit carrément changer de statut social”, souffle Nicolas Bottin, 46 ans, atteint de schizophrénie paranoïde.
Oui, faire la demande de RQTH, c’est avant tout devoir accepter “officiellement” qu’on a un handicap. Une étape difficile quand on évolue dans une société validiste. “C'est compliqué de sauter le pas. Pourtant, c'est un droit, et il ne faut pas hésiter à le demander. Mais à cause du regard de la société, on est nous-mêmes pris dans l'engrenage de penser comme tout le monde”, reconnaît l’ancien conducteur de car.
En cause, les préjugés que lui-même avait intégrés concernant les maladies psychiques : “Le terme de schizophrénie, c'est un terme vraiment très mal connoté dans la société. Je m’auto-stigmatisais en me disant : ‘C’est pas possible que j’en sois arrivé là’.”
“J’ai l’impression de ne pas être légitime à faire la demande”
À 25 ans, Lena est salariée en marketing. Épileptique, elle n’a pas encore sauté le pas de faire la demande de RQTH. Ce qui la freine en partie ? Un sentiment d’illégitimité nourri par le fait qu’elle côtoie des personnes “avec un handicap invisible plus lourd”. “Moi, c'est plutôt ponctuel, par flèche”, minimise celle dont le quotidien reste ponctué de crises d’épilepsie, de myoclonies - des spasmes musculaires incontrôlables - et d’absences.
Ce syndrome de l’imposteur, elle l’a aussi développé parce qu’au travail, on lui a bien fait sentir que son handicap n’en était pas vraiment un : “Je vois mal comment on va pouvoir m'accompagner sur un aménagement de poste sans que je donne l'impression d'en demander trop. Parce qu’il y a des matins où c'est très dur de se lever et d'aller au travail par rapport à l'état de fatigue et au risque de crise. Et souvent, on me dit : ‘T'en fais un peu trop’“, décrit-elle.
Qu’importe le genre des croyances limitantes, elles sont toujours renforcées par la nature même du handicap : invisible. “Tant qu'on peut le cacher, on le fait, notamment à l'employeur. Il y a encore cette réticence qui fait que le chiffre de 80% de handicaps invisibles ne se retrouve pas dans les déclarations de RQTH”, observe Matthieu Annereau, référent handicap chez la Banque Populaire.
Méconnaissance, galère procédurale, discrimination : des obstacles extérieurs
Mais avant d’entreprendre une demande de RQTH, encore faut-il en avoir connaissance. “Moi, il a fallu que j'attende dix ans de maladie pour qu'on me parle de monter un dossier. Parfois, il y a aussi la méconnaissance des médecins eux-mêmes sur la manière de monter le dossier”, pointe Fabrice Saulière, 56 ans, atteint d’un trouble bipolaire.
Et quand vient le moment de s’y mettre, c’est une autre paire de manches. “C'est même pas la peine de s'y attaquer en tant que particulier. Si tu n’es pas accompagné, il faut oublier”, assène le pair-aidant. “Je ne connais pas une seule personne qui fasse une demande de RQTH toute seule. La plupart du temps, c’est une assistante sociale qui va s'en occuper, et elle va regrouper toutes les pièces qu'il faut, y compris en s'adressant au médecin.”
Nicolas a lui-même été aidé par sa mère dans ce parcours du combattant et s’en rappelle le caractère éprouvant. “Combien de fois j’en ai pleuré”, souffle-t-il. Si la procédure est longue, elle n’est rien comparée à l’attente qui suit l’envoi du dossier : “Avec l'angoisse, je téléphonais régulièrement, et je pense que cette attente peut provoquer une augmentation des troubles psychiques chez certaines personnes.”
La rédaction vous conseille
“Il a fallu que je vende ma situation”
Un détail de cette procédure en particulier a marqué nos témoins : la lettre de motivation, à fournir dans le cadre du “projet de vie”. “Il faut expliquer pourquoi la RQTH est nécessaire dans le cadre de ta pathologie. J'ai été aidée d'un ami pour rédiger cette lettre de manière à ce que ce soit le plus ‘vendeur’. Il a fallu que je vende ma situation, quoi”, s’offusque Tiffany Mazars, 31 ans, atteinte d’une fibromyalgie.
“Dans le cadre d'une pathologie invisible, t’es tellement pas reconnu‧e… Quand t’as un fauteuil, c'est normal, il faut que tu aies une RQTH parce que t'as la vie dure quoi. Alors que quand tu as un handicap invisible, tu as aussi la vie dure, mais comme ça ne se voit pas, on ne te croit pas, donc t’es obligé‧e de te justifier”, analyse-t-elle.
70% des personnes avec un handicap invisible ne le mentionnent pas
Au-delà de tous ces obstacles, la peur de la discrimination est bien fondée : le handicap reste le premier motif de discrimination en matière d’emploid’après le Défenseur des droits. Concernant le handicap invisible, 41% des concerné‧es ont déjà subi une forme d’inégalité ou de violence (préjugés, placardisation, discrimination à l’embauche, rétrogradation…) d’après l’enquête Opinion Way.
Par peur d’être privées d’opportunités professionnelles, les personnes porteuses de handicap préfèrent ne pas faire de demande de RQTH ou, si elles en sont détentrices, ne pas la déclarer. “J’ai l’expérience d’un ami qui était en formation, c'était le seul de sa promotion à ne pas avoir trouvé de stage, et c’était le seul à avoir indiqué qu’il avait une RQTH et des troubles psychiques” confie Nicolas Bottin.
Nicolas, lui, a été licencié pour inaptitude professionnelle, avant l’obtention de sa RQTH et après avoir subi plusieurs bouffées délirantes au travail. Aux Prud'hommes, son employeur a fini par opter pour la conciliation, devant le risque d’une condamnation pour discrimination.
🚨 70% des personnes ayant un handicap invisible ne le mentionneront pas avant de signer un contrat de travail, 73% des salarié·es bénéficiant d'une RQTH déplorent des difficultés à rechercher un emploi et 65%déclarent avoir des difficultés pour évoluer professionnellement, contre respectivement 55%et 49% des salarié‧es n’ayant pas de reconnaissance officielle (Opinion Way)
La RQTH, un game changer ?
Si la promesse de la RQTH est de faciliter l’accès au travail des personnes concernées, la réalité du terrain est tout autre. Malgré l’obligation d’emploi (OETH) qui lui est attachée, certains employeurs préfèrent encore s’aquitter d’une pénalité financière - 30% des entreprises n’accueillaient ainsi aucun bénéficiaire de l’OETH en 2023 (DARES) - notamment parce qu’ils surestiment les difficultés liées à l’embauche d’une personne porteuse d’un handicap invisible.
C’est un fait : le plus grand paradoxe de la RQTH, c’est qu’elle ne garantit pas l’emploi. L’expérience de nos témoins est quasi unanime. “Même avec Cap Emploi (ndlr, l’organisme qui accompagnait les personnes handicapées dans l’emploi), ça ne collait pas, je ne trouvais pas de solution” se rappelle Nicolas, qui l’explique par “un manque de sensibilisation aux troubles psy et de formation du personnel”.
“On ne t’a pas embauchée pour ta RQTH mais pour tes compétences”
Ue fois mentionnée, elle peut aussi ne pas s’accompagner des aménagements prévus par la loi. “À l'obtention de la RQTH, mon patron, pour qui je travaillais depuis trois ans et demi, m'a dit : ‘Non, je n'ai pas envie d'apporter les adaptations’” se souvient, amère, Tiffany Mazars.
Elle démissionne, et subit une autre déception dans la petite PME où elle est ensuite embauchée : “Au bout de dix mois, mon état de santé s’est dégradé parce qu'ils n'avaient toujours pas mis en place le nécessaire. Quand je leur ai demandé si on pouvait parler des adaptations, on m'a clairement dit : 'On ne t’a pas embauchée pour ta RQTH mais pour tes compétences.' ”
En tant que pair-aidant, Fabrice n’a même pas besoin d’une RQTH pour qu’on se doute qu’il a un handicap. Et pourtant… “Quand j’ai retrouvé du boulot dans un hôpital, on ne me l'a même pas demandée. Et quand je l’ai fournie, personne ne m'a dit : ‘Vous avez besoin de quoi en termes d’aménagement ?’ Même côté médecine du travail, c'est passé au travers”, déplore-t-il.
“J’ai pris le parti d’afficher clairement mon handicap et ma RQTH”
Si Matthieu Annereau a lui aussi peiné à retrouver du travail, il s’en tire tout de même avec une expérience plus nuancée : “Ça a vraiment été du système D, des candidatures spontanées où j’ai pris le parti d’afficher clairement mon handicap et ma RQTH, en précisant que je maîtrisais les moyens techniques pour compenser mon handicap dans le champ professionnel”, se remémore-t-il.
Dix-huit ans plus tard, le salarié devenu non-voyant est toujours dans la même banque qui lui a donné sa chance à l’époque, et a pu bénéfier d’outils informatiques spécifiques ainsi que d’un chien-guide pour sécuriser ses déplacements domicile-travail. Peut-être parce que d’invisible, son handicap est devenu plus… visible, et donc, plus “légitime”.
Une étiquette qui stigmatise malgré tout
Globalement, l’étude d’Opinion Way en venait à conclure qu’au travail, la RQTH génère davantage de difficultés en divulguant et en concrétisant la situation de handicap. Car l’étape de la déclaration de la RQTH à l’employeur comporte ses propres enjeux. “La loi protège, mais complique, amorce Fabrice. La loi interdit à ton employeur de te demander ton handicap. Sauf qu'à un moment, tu vas avoir besoin de lui dire de quels aménagements tu as besoin. Donc déclarer sa RQTH, c'est quand même donner une indication à l’employeur”, observe-t-il.
Pour obtenir leurs droits, les porteurs‧euses de handicap se retrouvent effectivement à devoir, malgré eux, parler de leur handicap. Mais comment doser ce qu’on dit, comment verbaliser sans trop s’exposer ? “Parfois, on jongle avec les mots. Mais moi, j'en ai marre de mentir. Ça me fait du mal de mentir tout le temps, confie Nicolas. Tant pis, maintenant je dis ‘next’.Je me dis que, par un cercle vertueux, les personnes me reviendront en disant : “Il a raison en fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire qu'il est atteint de schizophrénie ?”
La rédaction vous conseille
“Les gens atteints de handicap, ils vont raisonner en termes de risques”
“Trop de gens ont des a priori pour que ce soit naturel de parler du handicap. Les gens atteints de handicap, ils vont raisonner en termes de risques. Ils ne sont pas sûrs d’être stigmatisés, mais la probabilité de l'être est tellement importante qu’ils ne veulent pas prendre le risque. Et les collègues, c’est le reflet de la population générale”, analyse Fabrice.
À la question, “Aujourd’hui, à quoi te sert ta RQTH ?”, Fabrice répond sans détour “À rien”. Il ne l’a d’ailleurs même pas renouvelée. Quant à Tiffany, si elle la renouvelle, “C'est juste pour l’honneur. Mais en tant que salariée, ça ne m'a jamais été utile”, concède-t-elle. Aujourd’hui TIH (Travailleuse Indépendante Handicapée), elle s’en sert aussi comme d’“un argument de vente, parce que notre mission dans l'entreprise va pouvoir être déductible de l’OETH au prorata du temps passé” ajoute-t-elle, pragmatique.
Améliorer le parcours RQTH pour un monde pro plus inclusif
Inutile, discriminante, stigmatisante… La RQTH est-elle bonne à jeter ? N’est-elle rien de plus qu’une étiquette qui enferme dans le handicap ? “C'est encore perçu par bon nombre comme cela, mais ça ne l'est pas, oppose Matthieu Annereau. Je peux le dire d’un point de vue collaborateur, moi qui vis avec un handicap depuis 20 ans, et d’un point de vue métier, étant référent handicap. On ne regarde pas le collaborateur à travers le prisme de son handicap”, tempère-t-il. Malgré les déconvenues qu’elle a pu expérimenter, Tiffany Mazars tient à sa RQTH qui a été “le seul levier de reconnaissance de maladie car la fibromyalgie n’est pas considérée par la Sécurité sociale”.
Les MDPH, un système opaque et inéquitable
La RQTH reste une avancée majeure dela refondation de la politique du handicap en 2005, et avec elle, la création des MDPH (Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées), ces bureaux ressources d'accès aux droits pour les concerné‧es.
Problème ? Pour le moment, elles restent dysfonctionnelles. Délais de traitement des dossiers allant de 4 à 17 mois, inégalités de droits (RQTH délivrée temporairement ou à vie), différences de nomenclatures sur les traitement des handicaps, opacité des critères d’attribution de la RQTH…
“Il faut plus de rapidité, plus d'équité. C'est très bien d'avoir des antennes départementales, d'être en proximité, mais ça crée aussi une question d’inéquité sur le territoire”, relève Matthieu Annereau, qui est aussi président de l’APHPP (Association pour la Prise en compte du Handicap dans les politiques Publiques et Privées).
L’urgence d’une task force nationale
Sur le volet des solutions, il a aussi sa petite idée : pour lui, il est urgent de “décomposer l'aspect traitement des dossiers de l'aspect accueil, information, renseignement au public”. Comment ? En créant, à côté de ces guichets départementaux, “une task force nationale avec une même nomenclature et des outils unifiés, donc hyper réactive sur le traitement des dossiers pour le descendre à moins de trois mois”.
Rendre visible le handicap invisible tout en le déstigmatisant
Dans un monde où le système d’attribution de la RQTH roulerait parfaitement, reste un problème essentiel : la rareté des demandes déposées et des déclarations RQTH faites à l’employeur. Sur ce point, aucun miracle ne peut advenir sans un effort de sensibilisation. “Il y a beaucoup de croyances limitantes de part et d'autre, des collaborateurs ou des managers” amorce Tiffany Mazars, conférencière sur le handicap invisible et partenaire experte d’une consultation citoyenne pour valoriser l'inclusion au travail. “Grâce à mes actions de sensibilisation, à chaque intervention, il y a au minimum une déclaration de RQTH qui est réalisée”, relève-t-elle avec fierté.
L’étude Opinion Way en a fait le constat : 93% des salariés portant un handicap - visible ou non - estiment que ce sujet n’est pas suffisamment investi par les entreprises (vs 62% des recruteurs). Et quand il l’est, l’engagement est surtout de façade : “Certaines boîtes avec pignon sur rue ont une politique RSE affichée sur leur site, mais en interne, ça reste des humains qui ont tendance à penser comme la société. Quelque part, je n’ai même plus envie d’affronter ce milieu professionnel”, soupire Nicolas Bottin.
Place aux role models
Parmi nos témoins, tous se sont engagés à leur niveau pour déstigmatiser le handicap invisible : Nicolas à travers son blog, Lena par le biais de son TikTok, Fabrice, Tiffany et Matthieu à travers leur métier-même. “C'est nous, acteurs, concernés, qui devons faire bouger les choses. Mais au-delà de la sensibilisation et de nos prises de parole, c'est de notre responsabilité”, affirme Tiffany Mazars. “Aujourd’hui, j’essaye vraiment d’être dans l'action. Parce que ce n'est pas juste d'avoir des dispositifs tellement solutionnaires et de ne pas les utiliser à bon escient. Et je continue de prôner cela, malgré le fait que je n'en ai pas bénéficié”, ajoute-t-elle.
“J’ai fait le choix de parler librement de mon handicap. C’est aussi à nous de démystifier les choses. Il y a 800 000 personnes atteintes de schizophrénie en France et il n’y en a pas beaucoup qui disent "moi, je suis atteint de schizophrénie'”, abonde Nicolas Bottin.
La rédaction vous conseille
Pour que la société évolue, la sensibilisation doit être généralisée : école, entreprises, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans la délivrance de la RQTH (médecine générale, médecine du travail) ou sa mise en application (France Travail).
“On est dans une société où on ignore superbement 12 millions de personnes. Ce qui nous permettra un jour que ça fonctionne bien, c'est d’être dans une société inclusive où le handicap ne posera de problème à personne” conclut Fabrice.