Julia Faure : d’Amazon à la lutte anti fast-fashion, itinéraire d’une iconoclaste
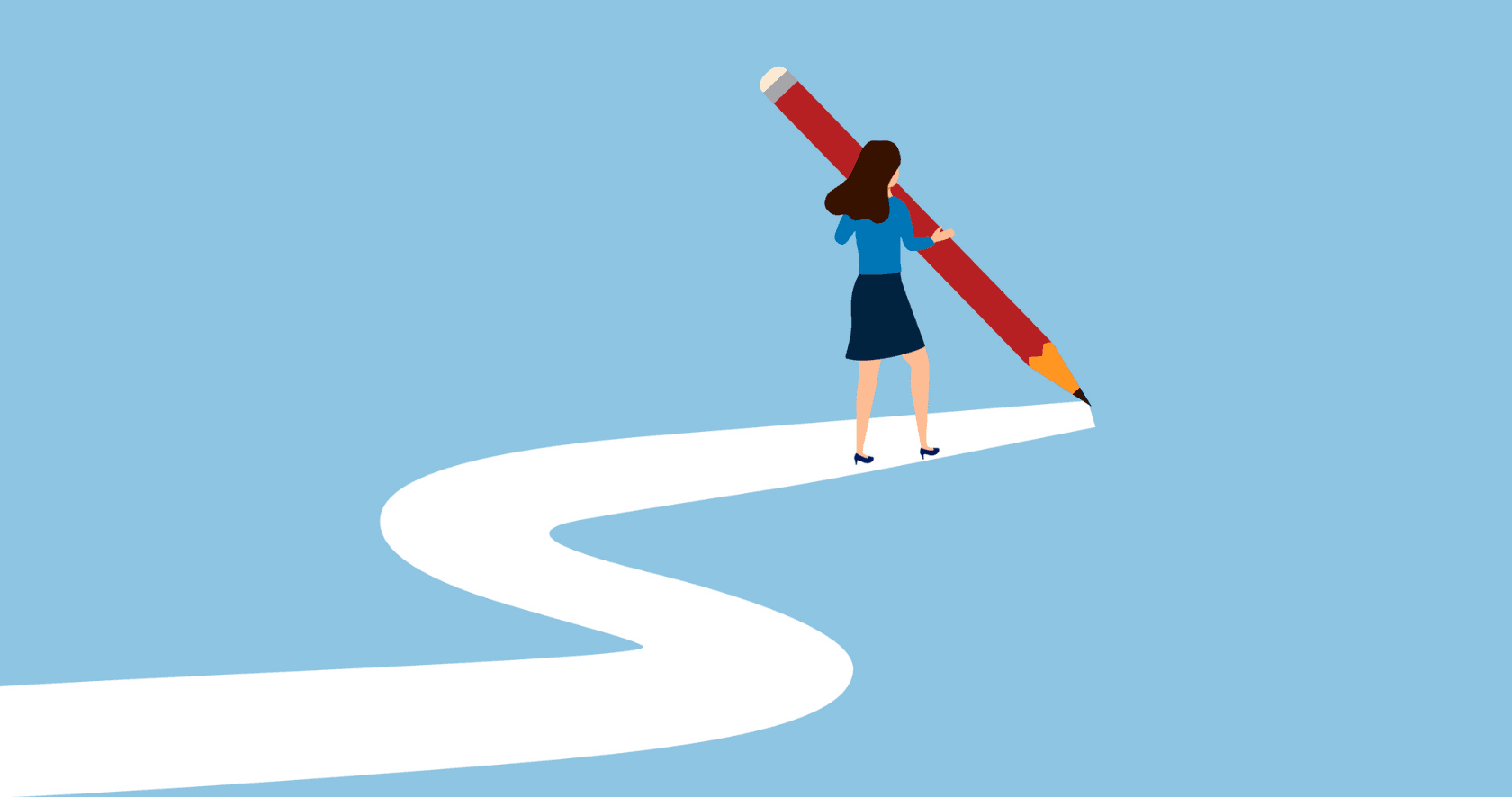
Pas de levée de fonds ni de campagnes de promotions, pas de coupes alambiquées ni de motifs tarabiscotés : chez Loom, la mode va à l’essentiel, à l’image de sa fondatrice qui ne se perd ni dans les périphrases, ni dans les considérations morales. Son vestiaire, produit en France et au Portugal, égrène les basiques du moment, le tout servi par un business modèle vertueux, qui croît tranquillement sous l'œil bienveillant de ses clients actionnaires.
Tout juste diplômée d’AgroParisTech, tu commences ta carrière chez Amazon. À ce moment-là, qu’est-ce qui te pousse à postuler ?
Julia Faure : J’aimais la logistique, et je ne trouvais pas qu’Amazon était une “mauvaise boîte”. Je me disais qu’au moins, ils étaient obligés de “salarier” leurs collaborateurs dans tous les pays où ils livrent, donc de se soumettre à la réglementation locale. À l’époque, c’était aussi une entreprise qui traitait bien ses clients. Il y avait une vraie rupture : on passait d’un modèle où on avait l’impression de se faire “arnaquer”, à une boîte qui rendait service, avec efficacité.
Tu as tenu 2 ans et 7 mois chez Amazon. À quel moment t’es-tu sentie désalignée ? Comment cela s’est manifesté chez toi ?
Julia Faure : C’est venu progressivement, notamment quand sont sortis les premiers écrits sur Amazon. Les conditions dans les centres logistiques, l’impact du e-commerce sur la planète… J’ai commencé à me renseigner, et, petit à petit, j’ai eu de moins en moins envie de travailler pour eux.
La rédaction vous conseille
Mais je ne suis jamais arrivée au point de ne plus pouvoir me lever le matin. J’aimais bien mon job, mes collègues étaient sympas, et mes tâches me plaisaient. C’était plus une perte de sens qu’autre chose. Quand j’ai senti que cela ne me convenait plus, j’ai commencé à penser à un nouveau projet.
En interview, j’ai lu que tu assumais pleinement d’être passée par un modèle de “non-sobriété”. C’est ce qui t’a permis de comprendre les valeurs qui t’animaient vraiment ?
Julia Faure : Oui. En tout cas, cela m’a permis de comprendre quel modèle économique je voulais servir, ou pas, et ce n’était pas une question que je m’étais posée avant. Chacun mène son parcours pour devenir la personne qu’il est aujourd’hui. Amazon est une boîte qui détruit beaucoup de choses, mais en termes de process et d’excellence opérationnelle, c’est une super école. Je ne regrette pas du tout mon passage : mon succès côté business, c’est en partie grâce à ce que j’ai appris chez eux.
La rédaction vous conseille
Après Amazon, tu es passée par La Ruche qui dit Oui. Comment as-tu vécu ce choc des cultures ?
Julia Faure : Il est clair que c’était une boîte plus jeune, plus engagée. Nos interlocuteurs étaient des agriculteurs et des responsables de ruches. Mais ce n’était pas un choc dans le sens où j’aurais eu du mal à m’adapter. Mes collègues partageaient mes valeurs, tout s’est donc passé de manière fluide car je savais où je voulais aller.
Outre tes premiers pas dans le monde professionnel, y-a-t-il eu un élément déclencheur dans ton parcours ?
Julia Faure : J’ai été marquée par l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Je faisais déjà attention à ma consommation de vêtements, je n’achetais rien produit à l’autre bout du monde. Mais il faut se souvenir que c’était une autre époque. Aujourd’hui, les “bifurqueurs” ont un peu d’avance dans leur réflexion parce qu’on voit de plus en plus clairement les conséquences du modèle économique actuel.
C’est en te prêtant au jeu des petites annonces que tu as trouvé ton cofondateur avec Loom. Le textile était le secteur que tu visais ?
Julia Faure : Ce n’était pas mon secteur d’études, mais dans mon entourage proche, j’ai énormément d’amies qui évoluent dans le textile. L’une est costumière, l’autre plumassière… J’ai toujours trouvé leurs métiers passionnants.
Le textile est un secteur grandement polluant, et dans nos sociétés, personne ou presque n’achète uniquement le strict nécessaire pour se vêtir. Comment gères-tu ce paradoxe ?
Julia Faure : Il n’existe aucune industrie qui ne soit pas polluante. Les moins polluantes sont des niches : produire, c’est polluer. Or, la mode est particulièrement touchée par la surproduction, donc elle pollue beaucoup. C’est une question de volume. Avec mon associé, nous tâchons d’aller à contre-courant des pratiques délétères. Et nous ne sommes pas les seuls : de nombreuses marques font des choses très bien dans ce secteur.
Faire autrement, cela passe aussi par le modèle économique de Loom : vous n’avez pas d’objectif de croissance, seulement de rentabilité. Aucun recours aux dark patterns. Est-ce difficile à tenir dans la société actuelle ?
Julia Faure : Nous arrivons à tenir cette ligne directrice, mais nous avons quand même un objectif de croissance. Nous avons fait une levée de fonds auprès de notre communauté, donc il nous faut atteindre une certaine taille critique pour être rentables et pouvoir rembourser l’argent investi par les particuliers.
Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place des garde-fous : pas de pub, pas de soldes massives, etc. Nous cherchons à atteindre cette taille de boîte “en faisant bien”, à notre rythme. C’est une croissance douce. Aujourd’hui, nous sommes huit dans l’équipe, dont trois qui s’occupent de la boutique.

Tu dis que “si les objets n’ont pas de valeur, le travail produit pour les fabriquer est également perçu comme dépourvu de valeur”. Comment agis-tu sur toute la chaîne de valeur, également pour revaloriser tes fournisseurs ?
Julia Faure : Nous faisons attention à produire dans des pays où le travail est protégé par la loi : essentiellement au Portugal, un peu en France (mais produire uniquement dans l’hexagone, économiquement, c’est compliqué). La désindustrialisation est telle que certaines usines ne peuvent plus faire ce que nous souhaitons en termes de qualité. À l’inverse, un pays comme le Portugal connaît une vraie émulation industrielle dans la sphère textile. Il est ainsi plus simple de maintenir des standards élevés.
La rédaction vous conseille
Où en es-tu de la création de ton "indice de réparabilité" ?
Julia Faure : Cet indice est un indicateur pour évaluer la probabilité qu’un vêtement soit réparé. Nous calculons le prix de vente neuf, et la différence avec le coût de réparation. Pour autant, nous ne proposons pas de garantie à vie. Un vêtement s’use. Les couleurs passent, les matières s’altèrent… Ce qu’il faut, c’est en prendre soin, le faire durer, le réparer si besoin, et quand il est vraiment en fin de vie, le transformer en chiffon. L’idée d’un vêtement “increvable”, c’est un mythe, et surtout, ce serait non biodégradable.
Le polyester, par exemple, rend les vêtements plus résistants mécaniquement, mais pose des soucis avec les microplastiques. En revanche, si un défaut apparaît dès les premières utilisations, nous échangeons les produits. Et nous accompagnons nos clients sur la réparation de nos vêtements.
Tu assumes que tout n’est pas parfait chez Loom : qu’est-ce que tu aimerais changer aujourd’hui encore ?
Julia Faure : Quand je pense que quelque chose doit changer… c’est simple, je le change. Mais oui, j’aimerais que nous ayons une meilleure direction artistique, du renfort dans l’équipe boutique. On pourrait aussi faire évoluer notre gamme de vêtements, proposer des coupes plus modernes, par exemple des jeans droits. Mais globalement, je suis déjà très fière du travail accompli.
Tu fédères aussi d’autres marques avec “En mode climat”, et tu es coprésidente du mouvement patronal Mouvement Impact France. Aujourd’hui, tu te sens plus militante qu’entrepreneure ?
Julia Faure : Non, je suis cheffe d’entreprise avant tout. C’est juste que le secteur dans lequel j’évolue m’oblige à voir les choses qui ne fonctionnent pas au global, et à utiliser ma voix pour tenter d’y remédier.
Faut-il déporter la responsabilité sur les entrepreneurs et l’État, et non plus les individus dans leurs choix de consommation ?
Julia Faure : La seconde posture est toujours d’actualité. Il n’y a pas un jour où l’on ne me demande pas si on ne devrait pas responsabiliser davantage les consommateurs. Maistant que certains produits seront légaux sur le marché, on ne peut pas attendre des citoyens qu’ils soient plus responsables que l’État lui-même. Il faut une réglementation sur les entreprises. Bien sûr, les consommateurs peuvent faire bouger les choses, pousser à l’évolution des lois, mais ça ne suffit pas.
Preuve des difficultés à mettre ces sujets à l’agenda des politiques, la loi anti-fast fashion a été repoussée. Sommes-nous revenus au temps du greenwashing… à moins qu’on n’en soit jamais sortis ?
Julia Faure : Dans les grandes lignes, la loi prévoit d’interdire la publicité pour l’ultra fast fashion, et de mettre en place des pénalités ou des primes selon l’impact écologique des produits mis sur le marché. La loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale il y a plus d’un an, mais elle doit passer au Sénat. Une première réécriture l’a vidée de son contenu. Nous avons jusqu’au 29 mai pour proposer des amendements afin de lui redonner de l’ambition. Elle sera votée le 10 juin. Si nous arrivons à la sauver, ce sera une grande avancée. Sinon, il faudra la faire repasser à l’Assemblée.
La marque Shein est invitée en grande pompe à VivaTech pour lancer un challenge à des startups, afin de "réinventer la mode circulaire". Qu’en penses-tu ?
Julia Faure : Ils ont de l’argent. C’est leur manière d’exister dans ces espaces-là, de se rendre acceptables grâce à leur puissance financière. Shein, ce sont des milliards de chiffre d’affaires en France. Leur business model cartonne. Ils vont être introduits en bourse à Londres. Cette loi anti-fast fashion pourrait représenter un vrai stop pour eux, donc ils dépensent sans compter pour peser sur le débat.
Ils ont débauché Castaner, ils recrutent des figures publiques comme Nicole Gage, une ancienne secrétaire d’Etat ou encore Bernard Spitz, ex-dirigeant du Medef… Ils ont lancé une énorme campagne de publicité avec Havas. C’est logique, ils ont beaucoup à perdre si la loi passe.
Ce qui est frappant, c’est que cela montre bien ce que l’argent peut acheter : du lobbying très puissant, qui influe directement sur la loi. On l’a vu dans la réécriture au Sénat. Cela ne se passe pas que dans les films. Plus tu t’attaques à des boîtes riches, plus leur capacité de lobbying est énorme.
Es-tu optimiste quant à l’adoption de cette loi ?
Julia Faure : Oui. Il y a clairement des forces qui s’activent du côté obscur. Mais il faut aussi que d’autres forces s’affirment en face. Pour cela, nous avons besoin de politiques courageux à l’image d’Anne-Cécile Violland, qui porte la loi anti fast-fashion. Le combat n’est pas encore perdu. Nous pouvons même le remporter.




